Pour qui grince le gond
La supercherie de l’Université commence avec ce mensonge selon lequel elle constituerait un monde à part de la production économique, une soi-disant société d’initiation intellectuelle, un cocon en dehors de l’Histoire chargé de former, bien à l’abri, les penseurs de demain. Or il n’en est rien, l’Université est un secteur parmi d’autres de la production économique, secteur dont la fonction est de former des futurs travailleurs. Le statut de l’étudiant n’est qu’un statut de transition en attendant l’intégration de celui-ci au salariat. S’il lui arrive de se salarier durant ses études, l’étudiant ne se salarie bien souvent que pour pouvoir étudier, et il n’étudie généralement que pour se salarier ensuite. Le salariat présent de l’étudiant est le simple moyen financier de ses études et le salariat futur est le but encore incertain de celles- ci : en attendant l’étudiant n’a que son statut d’étudiant pour lui servir de promesse. Et c’est parce que ce statut n’est rien d’autre qu’une promesse que les étudiants peuvent être si aisément les sujets de toutes les arnaques.
Le rôle d’étudiant est un rôle charnière : il n’existe qu’en- devenir, dans sa valeur (dépendante de son diplôme) de futur travailleur, dans les rôles potentiels qu’il est appelé à jouer ultérieurement dans le salariat. Ce que nous appelons « rôle d’étudiant » n’est donc pas un rôle figé mais un processus d’intériorisation d’un futur statut, sous ses différentes modalités. L’étudiant n’existe pas concrètement, il n’est pas une entité, il n’est jamais présent, simplement, en tant que dispositif, il fonctionne, dans des façons de penser et de faire plus ou moins conformes. Il est une figure de propagande, le surplus idéologique qui s’ajoute à tel ou tel contrôle local de la future main d’œuvre, le visage souriant de l’intégration paisible à l’exploitation économique.
Panopticoniversité
Le système éducatif est un secteur comme un autre de la production capitaliste, censé produire la force de travail intellectuelle plus ou moins qualifiée dont la fourchette de valeur dépend du grade de diplôme. Pour cela le système éducatif fonctionne comme institution disciplinaire, c’est à dire qu’il façonne des façons de voir, de penser et de se comporter, qu’il fait intérioriser des normes, qu’il opère une mise en conformité des individus avec le marché. Ces opérations se déroulent à couvert d’un fétichisme encore insuffisamment interrogé : celui du « savoir ». A peu près rien de ce qui est appris à partir du début du collège ne sera ni mémorisé, ni utile « plus tard » (faites le test vous-même : prenez le programme d’une classe de 5e). Dans la mesure où l’on nous bourre le crâne de connaissances abstraites, qui ne sont pas directement utiles dans nos vies quotidiennes, qui ne sont pas directement reliées à une pratique, c’est toujours le bachotage qui constitue la seule et unique organisation possible du travail d’étude : apprendre la veille, recracher le jour même, oublier le lendemain. C’est donc de compétition et de sélection sociale, doublé d’une question de dressage disciplinaire, dont il est question derrière les mythes de la « transmission des savoirs » et de la « qualification », et qui se réalise dans le système de notation.
Une note ne peut pas évaluer l’usage du savoir, et quand bien même elle le pourrait, la nécessité économique à laquelle la note est suspendue (note = diplôme = travail = argent = survie) fausserait déjà la donne. Le pseudo-savoir dispensé n’est pas la fin, mais l’alibi du racket de notre temps libre ; pour assembler quelques paragraphes de banalités à apprendre, recracher et oublier, il nous faut en passer par un enchevêtrement de contraintes : inscriptions, frais financiers, achat de matériel, réveil, transports, heure de pointe, horaires, règlements, autorités diverses (autorité du maître, autorité de l’administration, autorité infra-policière des vigiles…). C’est à tout un chacun de déterminer l’usage qu’il veut faire du savoir qu’il acquiert, mais l’étudiant n’apprend pas dans l’optique de faire usage de sa connaissance, il étudie dans l’optique de devoir être trié et sélectionné pour espérer avoir à bouffer un jour. C’est d’abord en ce sens que la liberté d’étudier qu’on nous oppose au moment des blocages est une absurdité, étudier n’est pas un droit ni une liberté, c’est une des diverses modalités proposées d’obéissance à une contrainte de masse : intégrer la sphère de l’exploitation économique. Toute analyse doit partir de là.
Ainsi, si nous tombons d’accord avec ces autocollants idiots qui pleurnichaient que « Les élèves ne sont pas des clients » c’est uniquement parce que nous savons que l’étudiant est, au contraire, une marchandise dont la valeur est en formation. Et si nous tombons d’accord avec ces badges idiots qui pleurnichaient que « Le Savoir n’est pas une marchandise » ce n’est que dans la mesure où nous savons bien que le « savoir » n’est que la mystification entourant le processus de production de la véritable marchandise universitaire : le futur travailleur. La notion de « consommation » que l’on met volontiers à toutes les sauces n’est pas à prendre au sens superficiel de « rapport marchand » mais de destruction d’un produit sous sa forme finie. Ce que l’étudiant « consomme » en cours ce n’est pas l’enseignement mais son propre temps libre. Et comme pour le temps de travail abstrait du salariat classique, ce temps revient sous sa forme coagulée habituelle : la valeur.
Ce que le diplôme universitaire sanctionne finalement, c’est l’achèvement d’une mise en conformité au système marchand et indique, en conséquence de cet apprentissage de la soumission, le prix auquel le travailleur pourra décemment espérer se vendre : la valeur du travailleur c’est la quantité de temps de liberté qui a été extrait du corps avec son propre consentement, la quantité de travail d’autocontrainte que celui-ci a effectué pour s’autoproduire ; et le diplômé est finalement cet être qui a écrasé ses qualités pour en faire des compétences mesurables, qui a fini d’opérer sa réduction quantitative pour pouvoir enfin être balancé sur le marché du travail. Pour se convaincre de notre propos, tout étudiant est invité à jeter un œil au livret de n’importe quelle U.F.R : le coefficient de valeur d’une unité d’enseignement dépend uniquement de son volume horaire, c’est-à-dire : 24 heures, 48 heures ou 72 heures. La misère de l’étudiant n’est ainsi rien d’autre que celle d’une autre figure bien connue, avec laquelle il se recoupe : le prolétaire. Ainsi de ce triste constat : rien ne relie positivement les étudiants entre eux, rien d’autre qu’une exploitation à laquelle ils sont sommés de s’identifier sous différentes modalités mystifiées.

Vous avez dit syndicalisme ?
Cette mystification du savoir, qui rejoint au final celle de la valeur d’usage sur la valeur d’échange, est le non-dit autour duquel tournent toutes les pseudo-critiques réformistes de l’université, même chez les enseignants autoproclamés « anticapitalistes ». Les professeurs ne sont pas dans le même bateau que les élèves, au contraire, ils occupent une position de pouvoir consistant à procéder à la disciplinarisation et au procès de valeur de ceux-ci. Il semblerait que certains anticapitalistes bavards aient arrêté de lire Le Capital à sa couverture : toutes les réflexions sur l’université s’arrêtent sagement au constat larmoyant que la marchandise universitaire ne se vend plus, ou de plus en plus mal. Tout au plus dénoncera t- on la dévalorisation croissante des diplômes sur le marché du travail, qui ne suscite chez personne, et surtout pas chez les professeurs, fussent –il « de gauche », un embryon de réflexion approfondie sur leur rôle et sur le système de notation et de contrôle de présence. Si les professeurs veulent, à l’avenir, pouvoir prétendre soutenir les mobilisations étudiantes, nous leur proposons deux modalités d’action très simples : la note maximale à tout le monde, ainsi que le refus du contrôle de présence. Et aussi qu’ils arrêtent de monopoliser la parole aux assemblées générales étudiantes, voire, en fait, qu’ils ne la prennent jamais. Ils ne peuvent jouer qu’un rôle de soutiens de leurs étudiants, et à ce titre ils doivent se taire et se mettre à disposition.
Les raisons de l’impensée critique que nous déplorons ici n’est pas à chercher plus loin que dans la plus banale analyse sociologique : comme institution de reproduction sociale, la fonction de l’université est de produire massivement du sous- travailleur intellectuel (à peu près jusqu’au niveau licence) puis du prof d’université (à partir du master). La direction de l’université, de ses différents pseudo-conseils « démocratiques » jusqu’à ses différents pseudos- syndicats (de l’UNEF à la CNT en passant par SUD) est ainsi totalement monopolisée par des profs, des fils de profs et/ou des futurs profs. L’expérience du mini- cycle de lutte qui va des grèves de 1995 jusqu’au mouvement des retraites de 2010 en passant par la LMDE, le CPE et les deux mouvements LRU, se clôt sur le constat en demi-teinte, non pas qu’il n’y aurait rien à attendre du syndicalisme étudiant, mais que le syndicalisme étudiant n’existe tout simplement pas, à l’heure actuelle.
Il existe un syndicalisme de profs et/ou de futurs profs, mais les intérêts étudiants ne sont pas représentés, et la condition des étudiants n’est pas pensée car le champ des luttes universitaires est parasité par ceux qui y tiennent, ou y tiendront, les rôles de contremaîtres. Nous avons perdu du temps à dénoncer la progression sécuritaire à l’Université, à nous mobiliser contre les caméras, les vigiles, à dénoncer peut être de façon anecdotique la collaboration de « certains » profs, de « certains » syndicats étudiants mais jamais des profs et des syndicats pour ce qu’ils sont. Nous avons perdu du temps avec les inepties autogestionnaires, nous avons perdu du temps à réclamer une gestion « alternative », voire une « autogestion » de l’Université, sans même savoir que l’Université était déjà autogérée par les professeurs. Le « Savoir » n’est pas en train de se « marchandiser » comme s’il existait a priori, comme une espèce de corpus tans-historique que l’on pourrait sauver au-delà du salariat. Le « Savoir » est une production sociale historiquement spécifique. En l’occurrence il s’agit du savoir « dominant », ou « légitime », à l’exclusion des autres.
Noblesse oblige
Ancienne « noblesse d’état », fin de race sentant le déclin de son petit règne, c’est tout naturellement que, à la faveur de la crise, la faune de profs soi-disant « gauchistes » connaît un virage de plus en plus réactionnaire, typique des classes- moyennes intellectuelles frustrées qui, au monopole de la critique, voudraient s’attribuer le monopole de la politique. Le fantasme du prof gauchiste est la « cité des philosophes », où il tiendrait bien évidemment le rôle du « philosophe » chargé d’éclairer le gouvernement. Privé de son emploi de « conseiller du Prince » au profit des technocrates, condamné à devenir toujours plus visiblement ce qu’il a toujours été essentiellement, c’est-à-dire un contremaître de la production de main d’œuvre intellectuelle (de moins en moins) qualifiée, le prof de fac tourne à l’aigreur. Plutôt que de s’essayer à une critique de l’économie politique conséquente de sa position, voir (pourquoi pas ?) une analyse sociologique de l’université, il saute dans la réaction à pieds joints. Le « déclin des valeurs », voila ce qui explique tout naturellement que personne ne daigne s’intéresser à lui et à son avis éclairé : ce doit être de la faute des « étudiants », ces petits monstres décadents et « consuméristes » (ah, le « consumérisme »), qui ne se soucient que de leur note (c’est-à-dire de leur future position sur le marché du travail, c’est-à-dire de leur survie matérielle) plutôt que de briller des yeux devant l’étendue de ce « Savoir » qu’il a la passion et la vocation de « transmettre ». Salauds d’étudiants !
La « solution », le « prof de gauche » l’a trouvé : il faut « renforcer la sélection à l’Université », c’est à dire faire redevenir celle-ci encore davantage l’unité de reproduction de la noblesse d’Etat qu’elle avait initialement la vocation d’être, c’est-à-dire qu’il faut foutre dehors ceux qui « n’ont rien à faire là » (« ON les a mis là vous comprenez »), c’est-à-dire les classes les plus populaires. Comme chez tout fonctionnaire, il est vain d’espérer un sursaut de radicalité chez le prof : il se rangera toujours naturellement du côté de son employeur. Sauf, évidemment, si le gouvernement se mettait en tête de lui faire faire un peu correctement son boulot, par exemple en instaurant un programme national à respecter et en établissant une inspection académique pour les enseignants- chercheurs. Outre le fait de daigner nous donner des enseignants qui soient diplômés dans la matière qu’ils prétendent enseigner. Tout cela serait largement plus intéressant pour les intérêts des étudiants que toutes les gesticulations plus ou moins pseudo- radicales des guignols de l’UNEF, de SUD, de la CNT et autres faux- syndicats étudiants qui ne font que mobiliser les étudiants pour les revendications de leurs profs.
Ce dont les étudiants sont privés c’est déjà de la capacité à penser politiquement leur situation, c’est-à-dire à se reconnaître comme pris dans l’alternative politique de la soumission ou de la révolte à leur exploitation ; à la place on les maintient dans le coma artificiel de la neutralité, bien à l’abri dans le nid idéologique douillet de « l‘Université » qui, soi disant, développerait leur esprit critique pour qu’il n’ait pas à subir mais à construire leur propre futur. « On rasera gratis demain », en attendant l’université comme lieu de production de la critique séparée n’est rien de plus qu’un long apprentissage détourné de la résignation professionnelle et de sa justification intellectuelle. On n’y parle peut- être pas toujours pour ne rien dire, mais on y pense systématiquement pour ne rien faire.
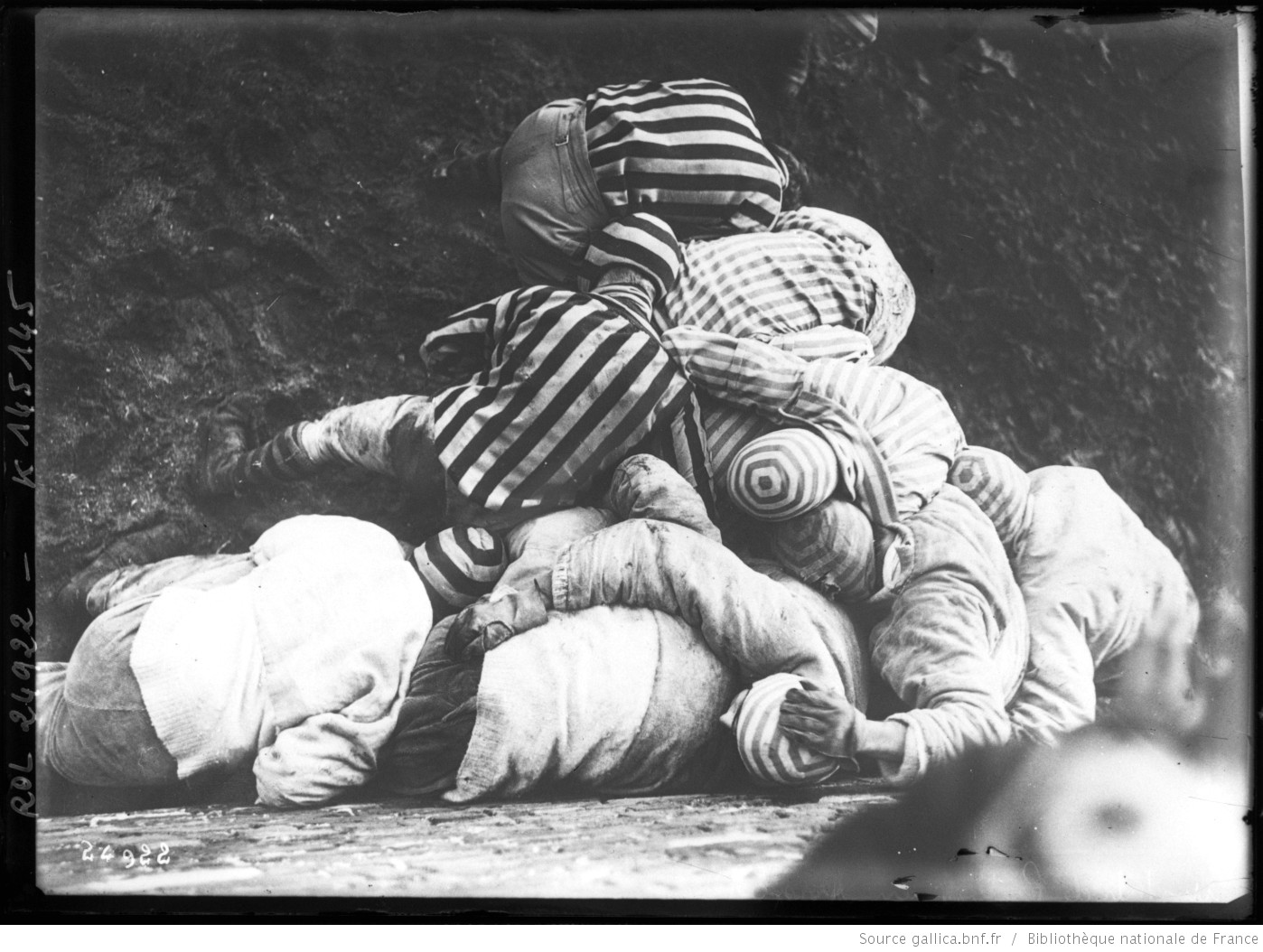
The show must go down
Le prolétariat auquel nous appartenons (que nous le voulions ou non, malheureusement) est un statut précaire, et précaire aussi en ce sens qu’il peut être remis en cause. L’ordre établi n’est jamais établi une fois pour toutes, il est, pour nous, une permanente défaite sans bataille sur un empire de passivité, c’est dire toute l’importance que le divertissement en est venu à occuper. Les étudiants sont ainsi les cibles privilégiées de l’illusion du loisir et du temps-libre, qui occupe une place prépondérante dans la propagande moderne.
Les sitcoms télévisées en sont l’exemple parfait. Prenons l’exemple concret d’une sitcom américaine (« How I met your mother ») : ce programme nous présente des stéréotypes de la classe- moyenne intellectuelle progressiste américaine (un architecte, une institutrice, une journaliste, un avocat écologiste et un businessman cynique) vivant des aventures incroyables pendant leurs heures de loisirs, aventures déjà incroyables par ce fait étrange qu’elles ont toute la capacité de se dérouler (sans empiéter sur leur sommeil) en dehors du temps de travail, travail qui n’est presque jamais représenté, tout étant fait pour convaincre le spectateur que le temps de loisir constituerait un temps à part, autonome et propice à des aventures fantastiques, permettant une réalisation individuelle et un renforcement et un approfondissement des liens collectifs.
Propagande grossière, évidemment, il suffit de s’adonner à une de ces minables alcoolisations puériles qui entrecoupent les heures de cours des étudiants pour découvrir le fossé qui règne entre le spectacle et la vie réelle : malgré le fait que les étudiants tentent d’imiter les héros des séries qu’ils ingurgitent, l’aventure n’est jamais au rendez-vous de la fête. Ou, comme le disait ce slogan griffonné sur un mur de Paris, un beau jour de mai : « Dans une société qui abolit toute aventure, la seule aventure qui demeure est l’abolition de cette société ! ».
Étudiants de tous les pays...
Malgré toutes les prétentions de certains militants à « sortir » du milieu universitaire, et malgré le mépris qu’ils affichent pour « l’étudiant » l’université demeure malgré tout, par sa nature, un lieu privilégié de production de la critique, même si celle-ci demeure souvent séparée de la pratique. Le snobisme anti- universitaire de certains radicaux ne dissimule souvent que leur mauvaise conscience sociale et le mépris refoulé qu’ils ont d’eux-mêmes : lorsqu’ils brocardent « l’étudiant », ils confondent bien souvent les étudiants réels et la représentation spectaculaire de l’étudiant, dont ils sont souvent eux-mêmes les plus emblématiques. Quoiqu’il en soit ce snobisme est désuet depuis quelques décennies : nous ne sommes pas les étudiants de mai 68, nous ne sommes pas issus de la même époque, nous dit-on, mais surtout pas de la même classe sociale. Quoiqu’on en dise, il n’y a statistiquement pas, ou très peu, de « petits- bourgeois » à l’Université, et il suffit très simplement d’aller chercher les statistiques officielles pour s’en rendre compte.
On doit à Bourdieu et à sa notion de « capital culturel », utilisée n’importe comment par les milieux gauchistes, cette généralisation grotesque du terme de « petite- bourgeoisie ». Il faut le redire ici : le « capital » est un rapport de production, fondé sur la propriété privée des moyens de productions permettant une exploitation en vue d’une reproduction élargie (accumulation). Les ressources ne sont du « capital » que si elles permettent d’établir un rapport d’exploitation en vue d’une accumulation. Un travailleur intellectuel n’est donc pas un « bourgeois » mais un « travailleur », donc un « prolétaire ». Il ne dispose pas de « capital culturel » mais d’une « force de travail intellectuelle » qui lui permet simplement d’être exploité à un taux de rémunération et de valorisation sociale et symbolique supérieure à celui du prolétariat ouvrier. Les étudiants ne sont donc pas des « petits- bourgeois » mais du prolétariat intellectuel plus ou moins qualifié. Simplement à la catégorisation économique, assez simple, des classes correspond une réalité sociale plus stratifiée et plus complexe même si, à la faveur de la moindre crise, cette pseudo- stratification complexe se resserre vite aux deux points antagonistes classiques de la polarisation capitaliste.
Loin de l’image fantasmée qu’ON fait entretenir aux étudiants à leur propre sujet, ce je-sais-tout qui serait gentiment précaire et romantiquement révolutionnaire, et qui ne demanderait soi- disant rien de mieux que de pouvoir donner son avis pour que la gestion de la misère, à commencer par la sienne, soit « plus démocratique », la misère de l’étudiant implique un rapport de force permanent. Face à leurs contremaître, qu’ils soient professeurs, chargés de T.D ou syndicalistes, les étudiants sont seuls, et penser notre situation implique une violence à laquelle nous ne sommes pas habitués, et c’est seulement cette violence que l’on nous reproche à chaque mouvement, à chaque grève, à chaque blocage. L’université est un secteur économique parmi d’autres, sur lequel il importe tout autant de mener la lutte. Nous avons pris notre part à ces luttes, nous prendrons notre part à celles à venir.
La brochure au format .pdf :






