Dans ton chapitre, tu présentes la ville durable comme « une manière de poursuivre et de légitimer un discours de croissance tout en valorisant un compromis entre ville et environnement ». Quelle est la place de la notion de « durable » dans la ville capitaliste ?
La rhétorique autour du « durable » est florissante dans tous les domaines de la vie et de la consommation. Cela se traduit notamment dans la production de la ville par des expressions de type « ville durable », « quartier durable », « écoquartier », qui accompagnent d’autres notions comme celles de « ville inclusive », « smartcity », etc. Ce qui distingue la notion de « ville durable », c’est qu’elle repose sur des contradictions fortes. Elle est issue à la fois des mouvements contestataires écologistes qui ont remis en cause les effets du capitalisme sur les territoires et notamment la manière de faire les villes depuis les années 1970, mais elle reprend aussi les mots d’ordres diffusés au niveau international dans les années 70 et 80, et qui prétendaient concilier développement économique, préservation de l’environnement et lutte contre les inégalités.
Dans l’urbanisme, la ville durable fonctionne comme un mot d’ordre très consensuel. D’une part, ça a été une manière pour un certain nombre d’acteurs de la construction ou de la conception (architectes, urbanistes, ingénieurs, etc.) de relégitimer leur action dans la production urbaine, de verdir leur image. En effet, les discours sur la croissance urbaine et démographique des villes commencent à être remis en cause au regard des effets observables parfois contestés localement : artificialisation, « bétonnisation », construction de routes et d’infrastructures... Les acteurs de la production urbaine, publics comme privés, ont conscience que leurs projets sont de moins en moins acceptés. À défaut de changer en profondeur leurs pratiques, ils modifient leurs discours en les verdissant. D’autre part, ce mot d’ordre répond à une attente sociale : avoir accès à un cadre de vie plus agréable et plus sain, bénéficier d’espaces verts ou adopter des modes de vie plus écologiques.
Dans le contexte de concurrence que se livrent les villes, où chacune veut se faire une place sur le marché de l’attractivité territoriale, le durable est perçu comme un argument décisif pour attirer des investisseurs et une hypothétique « classe créative », ces classes supérieures qui constitueraient la plus-value des métropoles contemporaines en tirant le développement économique vers le haut. Il s’agit donc de valoriser la qualité de vie, le dynamisme, la fête, de proposer une ambiance, une image urbaine, qui sont renouvelées par le durable.
Finalement, cette « ville durable » est une forme d’incorporation de la critique écologiste au capitalisme urbain, qui agit en retirant à cette critique sa charge contestataire et émancipatrice. Son caractère consensuel a fait de ce mot-valise le paradigme dominant de l’urbanisme contemporain.
Pourtant, l’émergence de cette notion ne remet pas en cause la production néolibérale de la ville, qui se caractérise par un certain nombre de tendances : consommation foncière, « reconquête » des quartiers populaires, production de grandes opérations immobilières et industrialisation, standardisation du bâti, mimétisme des architectures...
Exactement. Même si quelques expériences très minoritaires tentent d’ouvrir d’autres pistes, la plupart des écoquartiers et des grands projets de ville durable qui sont développés en France s’inscrivent dans la continuité des manières de produire la ville que l’on connaît depuis les années 70. On met un peu plus d’espaces verts, qui sont en réalité des espaces paysagers agréables à la vue plutôt que des espaces praticables ; on développe des discours autour des économies d’énergie, qui sont avant tout un argument de vente ; on met en avant des logiques participatives, qui sont à la fois un argument de vente et une manière de neutraliser les conflits qui peuvent naître autour d’un projet urbain. Mais on ne change pas fondamentalement la manière de produire la ville.
Dans le livre, tu décris les écoquartiers comme « un des emblèmes de la ville durable ». Peux-tu revenir sur l’histoire de cette notion et son déploiement en France ?
Avec la diffusion du discours autour du développement durable, la question urbaine est rapidement devenue centrale. Certains acteurs de la production urbaine (élus, entreprises de la construction, promoteurs...) se sont aperçus que le durable était un moyen potentiel de valoriser leur action et d’accompagner la production urbaine d’un nouveau discours. La ville durable s’est donc rapidement traduite par des projets urbains spécifiques. En France, cette démarche a été soutenue et accompagnée par le ministère en charge du développement durable, sous la forme d’appels à projets et de labels pour mettre en concurrence et récompenser les meilleurs projets d’écoquartiers.
Cette labellisation va à la fois diffuser ce modèle, normer les manières de faire, et engager une multitude d’acteurs de la construction et de la promotion immobilière dans cette voie. Les écoquartiers vont ainsi apparaître comme la manière privilégiée de construire la ville durable. On aurait pu envisager d’autres logiques. Alors que ces écoquartiers sont, pour la plupart, de nouveaux projets urbains, de nouveaux quartiers à construire, peu d’actions sont menées sur la ville existante. Tout ce qui fait la ville, le déjà-là, est peu concerné, car dans une logique de valorisation des activités et de marketing, on cherche avant tout à produire du nouveau. C’est avec un nouveau quartier qu’on va rendre les choses attractives, qu’on va mobiliser des investisseurs, des élus, qu’on va attirer d’hypothétiques classes créatives qui ont les moyens d’accéder à ce type de quartiers... Et sur le temps d’un mandat, on peut commencer à développer un écoquartier et le valoriser dans son bilan en vue des élections suivantes.
Quel regard portes-tu sur le projet d’écoquartier du Plessis-Botanique ? A-t-il des propriétés qui le distinguent d’autres projets de ce type ?
Je n’ai pas spécifiquement travaillé sur ce quartier dans mes recherches, mais il reprend des discours et des arguments que l’on retrouve dans beaucoup de projets actuels en France. Ce qui m’a frappé en lisant les documents mis à disposition par la mairie de La Riche, c’est qu’il n’y est pas question de ce qui existait auparavant sur l’emprise du projet. On comprend, au détour de certaines phrases, qu’il s’agissait de friches maraîchères. Le discours valorise la nouveauté et l’innovation, en passant sous silence les pratiques et les rapports au territoire qui pouvaient exister.
J’ai aussi été frappé de voir que le projet porte sur une zone inondable sans que cela ne soit un élément central du projet mené. Le caractère inondable va bien au-delà des limites de l’écoquartier, mais dans ce projet on aurait pu justement s’appuyer sur le fait qu’il s’agit d’une zone humide potentiellement riche d’un point de vue écologique et de biodiversité. Au contraire, le parti pris est le suivant : on bétonne, mais on ne va pas habiter en rez-de-chaussée des bâtiments pour éviter les risques. C’est révélateur d’un rapport à l’environnement que l’on peut qualifier de productiviste : il faut poursuivre l’urbanisation et donc consommer les ressources foncières, sans réellement prendre en considération les fonctionnements du territoire et chercher à le préserver.

Parmi les éléments de la communication sur le projet qui m’ont marqué, un promoteur immobilier promet aux acquéreurs de ses logements « un sentiment d’équilibre avec la nature » : on ne met pas en avant la nature, mais on vend un sentiment, une image, une ambiance. C’est une approche assez cynique, mais qui fonctionne : ce « vert » mis en scène est avant tout un élément de valorisation des prix immobiliers. Dans un autre discours, il est question du « modèle de la cité-jardin », qui fait complètement abstraction de la dimension sociale et collective de ce modèle urbanistique qui date du début du XXème siècle. Là, on vend un modèle complètement dépolitisé, sans prise en compte de la gestion des communs et de l’espace public : on n’a gardé de la notion de la cité-jardin que les deux éléments qui la composent, la cité d’un côté et le jardin de l’autre. Dans ce projet, les espaces collectifs ne sont pas des espaces publics : ce sont des cœurs d’îlots gérés par des copropriétés, dont on comprend qu’ils ont avant tout un rôle d’agrément visuel. Les espaces publics, qui sont avant tout les espaces de la rencontre et du débat dans une ville, sont assez réduits, et finalement assez symboliques : un petit carré de jardin, et une petite place centrale complètement minéralisée.
La présentation de l’écoquartier est assez révélatrice d’une absence de projet collectif : on ne va pas du tout vers une nouvelle manière de concevoir la ville, et ce qui est donné à voir ne contient aucune bribe d’émancipation. Il s’agit simplement de peindre en vert le réinvestissement d’une friche en cœur de ville, avec des potentiels de rentabilité importants. S’agissant du bâti, on est à 15% de « locatif social », ce qui est présenté par la municipalité comme quelque chose d’important, alors que c’est très en dessous des obligations légales à l’échelle d’une ville : on organise un déficit de logements sociaux dans ce nouveau quartier.
Le futur écoquartier intègre également un projet d’habitat participatif.
Oui, cet argument est très présent dans la communication sur le projet. Cela ne représente que 8 logements neufs sur les 1 400 que comptera le quartier, mais cela n’empêche pas la mairie de « survendre » cet aspect du projet, en se glorifiant de participer à inventer de nouvelles manières de faire la ville. Peu de choses sont annoncées sur la démarche qui va être menée, mais vu le très faible nombre de logements concernés, on voit bien qu’il ne s’agit pas d’un levier pour envisager une production alternative de la ville.
Cela pourrait être intéressant si c’était le point de départ d’une réelle expérimentation. Les projets d’habitat participatif peuvent permettre de mener une réflexion sur les manières de concevoir l’habitat aujourd’hui, en court-circuitant les processus de la production immobilière, en mettant en avant la valeur d’usage des lieux de vie par rapport aux logiques de marché, en déconnectant ces logements des marchés immobiliers via des clauses de non-spéculation, etc. Ici, on a le sentiment que l’intégration de ce projet sert d’alibi de participation, et qu’il permet de diluer d’éventuelles critiques sur le bien-fondé du projet. D’autant plus qu’en dehors de cet habitat participatif, l’ambition du projet d’écoquartier en termes de participation a l’air très faible : il est simplement fait mention d’une enquête publique, ce qui correspond à une obligation légale.
La participation, dans les écoquartiers, est souvent employée pour neutraliser la critique face à un projet urbain en construction. La labellisation joue également un rôle important dans la neutralisation de la critique écologiste sur les écoquartiers. Les associations ont très peu de prise critique sur ce type de projets, elles ont beaucoup de mal à développer un contre-discours, en raison de tout le récit mobilisé autour de la « durabilité », qui est associée à la protection de l’environnement et au bien commun.
C’est effectivement ce qui ressort du lexique employé par Wilfried Schwartz, le maire de La Riche, dans la présentation qu’il fait du projet. Il y est question de « développement éco responsable », de « qualité de vie retrouvée » ; d’un quartier « à taille humaine », de « modes de logement innovants », de « ville durable et solidaire » construite « en concertation avec les habitants ».
Il s’agit d’une succession de mots-valises chargés d’une connotation positive, qui neutralisent ou a minima rendent très difficile un positionnement critique. La question écologique dans la production urbaine est un enjeu essentiel pour l’avenir. Cela doit nous conduire à sortir des manières de produire les villes actuellement, qui sont incompatibles avec une réelle transition sociale et écologique, à débattre des scénarios possibles et à assumer de vrais choix. Mais aujourd’hui, derrière un vernis vert et participatif, la production urbaine traditionnelle se poursuit.
Peut-on parler, à propos des écoquartiers, d’une forme de greenwashing de la production urbaine ?
Sur le fond, oui. On est bien dans l’intégration d’éléments « éco-quelquechose » pour se vendre sur un marché de l’immobilier, par exemple dans le cas de la ZAC du Plessis-Botanique. L’urbanisme a aujourd’hui un fort versant communicationnel, et la production de discours est fondamentale. Le greenwashing, c’est ça : la production de discours et des ajustements marginaux, sans transformation fondamentale de la manière de produire la ville. Mais la critique de ces projets ne doit pas s’arrêter à la dénonciation du greenwashing, car cela réduit la portée critique à une hiérarchisation des projets en fonction de leur performance écologique. Or, l’urbanisme développe également une forte dimension moralisatrice et responsabilisatrice, et même sécuritaire.
Les manières dominantes de faire la ville aujourd’hui ont tendance à distinguer les populations. D’un côté, il y a les classes sociales qu’on cherche à attirer dans les écoquartiers, ce sont les fameuses « classes créatives » précitées, ces classes supérieures qu’on veut voir participer au développement économique des métropoles. Ce mythe des « classes créatives » est bien ancré chez les acteurs publics comme privés, qui mettent beaucoup d’énergie et de moyens à se positionner dans cette concurrence pour l’attractivité. Ces acteurs vont alors chercher à répondre à leurs attentes supposées, par des projets urbains spécifiques, par des discours et un marketing territorial.
De l’autre côté, certaines populations ou pratiques sont vues comme indésirables. Des politiques urbaines vont alors chercher à les éloigner ou leur faire adopter des comportements plus « responsables » (désormais « éco-responsables »). On développe des discours moralisateurs sur les pratiques, notamment individuelles, autour des éco-gestes, des déchets ou de l’usage de la voiture, sans mettre en question ce qui conduit à utiliser la voiture ou à surconsommer. On va même jusqu’à contraindre et surveiller les usages, notamment en recourant aux avancées technologiques qui accompagnent le déploiement de la « smart city » ; c’est le cas des logements intelligents, qui vont émettre des alertes lorsque sont identifiés des usages qui sortent de la norme. Or, cette norme telle qu’elle est définie renvoie à des pratiques jugées légitimes, qui sont socialement marquées : les injonctions et contrôles exercés tendent à délégitimer les pratiques populaires.

Des sociologues ont travaillé sur cette invisibilisation des pratiques populaires au profit d’une valorisation des modes de vie dominants, davantage ancrés dans des modèles de consommation capitalistes. Il y a là une forme de hiérarchisation des manières de vivre, et celles et ceux qui ne correspondent pas au modèle de l’« éco-citoyen » se voient soumis à un ensemble de contraintes, de formes de responsabilisations et d’injonctions morales. Or, de nombreux travaux scientifiques montrent bien que les pratiques des classes populaires ont une empreinte écologique plus faible, ne serait-ce que parce qu’elles ont moins tendance à prendre l’avion, se projettent davantage dans des réseaux de solidarité locaux, et ont parfois hérité d’une forme de culture de la sobriété. Mais au travers des écoquartiers, c’est bien une reproduction de ces rapports de domination qui est à l’œuvre.
Cette question de la hiérarchisation sociale rejoint d’autres formes de domination. En travaillant sur la question du genre dans les écoquartiers, on s’aperçoit que parmi les catégories dominées, ce sont les femmes qui subissent le plus les contraintes et les injonctions aux usages qui sont à l’oeuvre dans ces espaces. J’ai l’exemple d’un parc, dans un quartier de Rennes, où avait été décidé de ne pas installer d’éclairage pour préserver la biodiversité ; cela obligeait les femmes à faire des détours importants pour rentrer chez elles, ce qui rallongeait fortement les trajets et favorisait un sentiment d’insécurité. Par ailleurs, dans la mesure où les femmes restent davantage à la maison — notamment parce qu’elles connaissent des taux de chômage plus élevés —, et où l’organisation patriarcale de la société fait reposer sur elles la gestion et l’entretien du logement, toutes les injonctions qui concernent les intérieurs des logements s’exercent d’abord sur elles. Cela touche aux produits d’entretien qu’on peut utiliser ou pas, des consommations d’eau, etc. Cette responsabilisation, qui peut prendre la forme d’une culpabilisation individuelle, s’ajoute aux situations souvent précaires de ces femmes.
Tu parles dans le livre de « sélectivité sociale du peuplement » des écoquartiers, et de « gentrification écologique ». Tu peux développer ?
Dans la plupart des écoquartiers que j’ai analysés, on cherche à attirer des classes moyennes supérieures, voire des classes supérieures. Les logements sociaux qui y sont construits ne sont souvent pas destinés aux populations les plus pauvres, et divers outils sont déployés pour augmenter le prix des loyers, en construisant la gamme de logements sociaux aux loyers les plus élevés [1], ou en jouant sur certaines caractéristiques des logements pour éviter les familles nombreuses par exemple. Cela produit des effets en termes de mixité de l’habitat et de diversité sociale. Si l’on ajoute les questions de domination précédemment évoquées, on a donc une forme de gentrification qui est double : elle touche à la fois à l’occupation, à la composition sociale de ces espaces, et au contrôle social qui s’y exerce.
Dans la mesure où la notion de gentrification a été assez largement appropriée par les opposant-es à la production capitaliste de la ville, est-ce que le recours à cette idée de « gentrification écologique » n’est pas une piste pour dynamiser la critique de ces écoquartiers, dont on a vu par ailleurs qu’elle était difficile ?
Il est souvent délicat de développer un discours général sur les écoquartiers, car ils se situent dans des contextes urbains différents, adoptent des tailles différentes, se donnent des objectifs a priori différents. Mais nous avons désormais le recul nécessaire pour porter un regard global sur ce type de projets : on retrouve très souvent les mêmes discours, la même manière de concevoir la ville, des espaces similaires, une grande homogénéité architecturale, etc. Les tendances de fond que j’ai présenté précédemment sont assez proches dans la plupart des écoquartiers. Le recours à la notion de gentrification est tout à fait justifié, car elle porte une charge critique de remise en question des manières d’appréhender l’écologie dans la production urbaine. À mon sens, il est cependant nécessaire d’articuler deux types d’analyses que j’ai évoqué précédemment : d’une part les tendances à la spécialisation sociale de ces quartiers, et d’autre part le contrôle social et les formes de gouvernementalité qui s’y exercent.
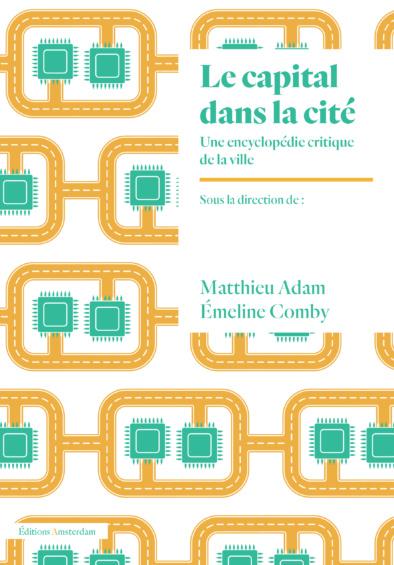
Matthieu Adam, Emeline Comby (dir.), Le Capital dans la cité. Une encyclopédie critique de la ville, Éditions Amsterdam, 2020, 25 €.





